Pris pour une gastro-entérite aux urgences, un enfant de deux ans décède à domicile le jour suivant
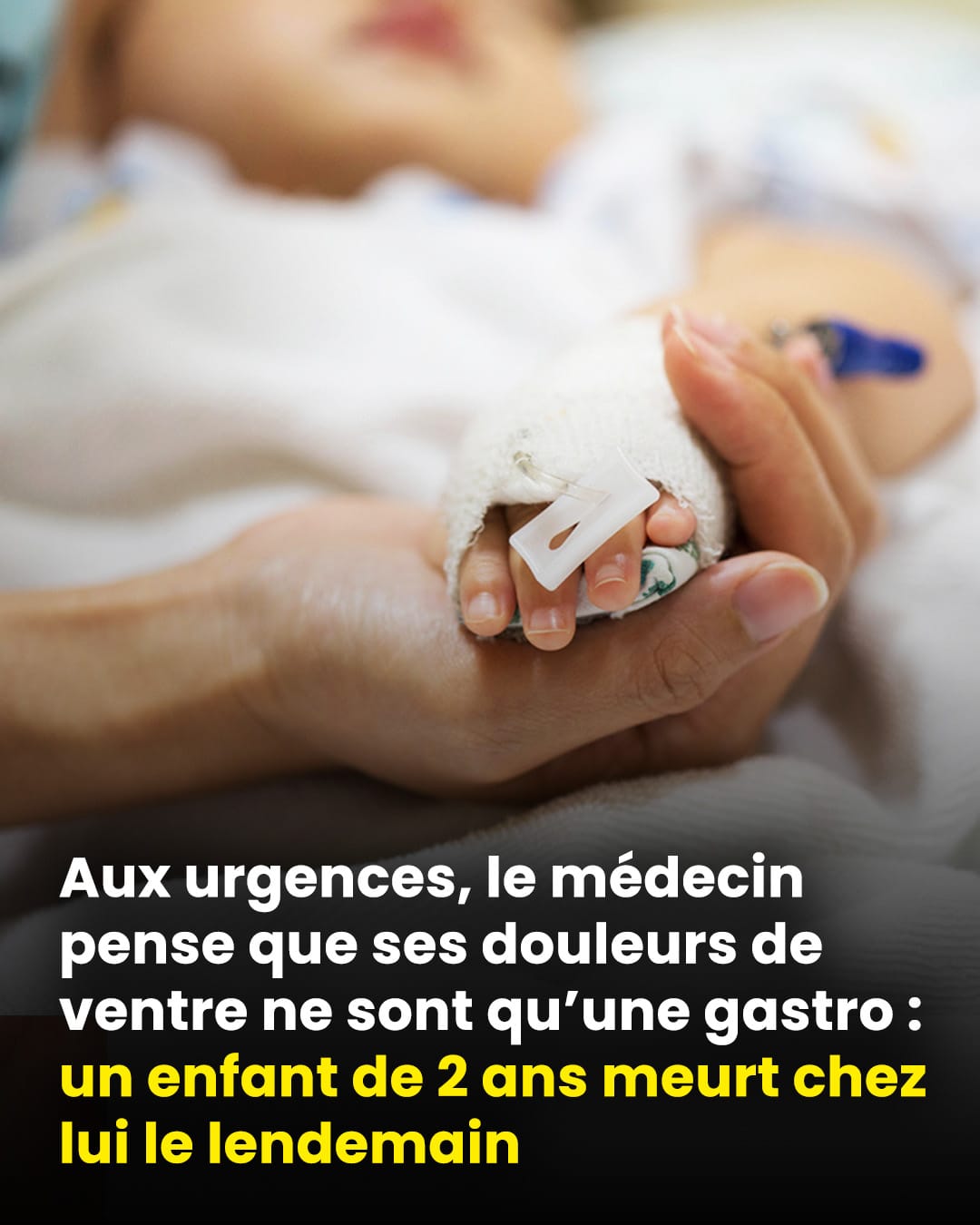
Lorsqu’un enfant tombe malade, les parents font naturellement confiance aux professionnels de santé pour poser le bon diagnostic. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance est ébranlée par une erreur médicale ?
C’est ce qu’a vécu une famille du Nord de la France en 2013. Leur fils de 2 ans, souffrant de douleurs abdominales, a été renvoyé chez lui avec un diagnostic de gastro-entérite. Le lendemain, il décédait des suites d’une complication non détectée.
Douze ans après le drame, le médecin responsable a comparu en justice pour homicide involontaire. Ce cas pose une question essentielle : comment éviter que de telles erreurs se reproduisent ?
Un diagnostic erroné aux conséquences fatales

En hiver, les infections virales comme la gastro-entérite sont fréquentes, notamment chez les enfants. Vomissements, diarrhées et douleurs abdominales sont des symptômes courants, mais ils peuvent aussi masquer des pathologies plus graves.
Ce jour-là, les parents du petit garçon se rendent aux urgences d’Armentières, inquiets par son état. Il vomit sans arrêt et se plaint de douleurs intenses au ventre. Après un examen rapide, le pédiatre de garde diagnostique une simple gastro-entérite, sans suspecter de complications. Il prescrit des soins légers et laisse l’enfant rentrer chez lui.
Mais quelques heures plus tard, la situation tourne au drame. L’enfant décède à son domicile, victime d’une nécrose intestinale qui aurait pu être évitée avec un diagnostic plus approfondi.
Une pathologie rare ignorée par le médecin

L’enquête révèle que l’enfant souffrait d’une malformation digestive connue depuis sa naissance. Ce détail, pourtant essentiel, n’a pas été pris en compte lors de son passage aux urgences.
L’autopsie confirme que l’enfant est mort d’un choc hémorragique dû à une nécrose intestinale, une complication grave nécessitant une prise en charge immédiate.
Ce cas met en lumière un problème récurrent dans certains services d’urgences : le manque de prise en compte des antécédents médicaux et la tendance à poser un diagnostic rapide sans examens approfondis.
Un procès pour homicide involontaire

Douze ans après les faits, le médecin ayant examiné l’enfant a été jugé pour homicide involontaire. En larmes à la barre, il reconnaît son erreur et admet ne « pas avoir pris la bonne décision ». Ses confrères soulignent qu’il s’agissait d’un problème de jugement, une erreur malheureusement lourde de conséquences.
La procureure a requis la relaxe du médecin, mais la décision finale a été rendue le 5 février dernier. Cette affaire divise l’opinion : certains estiment que la faute mérite une sanction exemplaire, tandis que d’autres considèrent qu’il s’agit d’une erreur humaine.
Comment éviter de telles erreurs médicales ?
Face à ces drames, plusieurs mesures pourraient être mises en place pour réduire les erreurs de diagnostic :
- Toujours mentionner les antécédents médicaux : lors d’un passage aux urgences, les parents doivent insister sur les pathologies existantes de leur enfant.
- Ne pas minimiser des symptômes inhabituels : des vomissements persistants, des douleurs intenses et une grande faiblesse doivent alerter et justifier un deuxième avis médical.
- Améliorer la prise en charge aux urgences : des examens complémentaires (échographie, prise de sang) devraient être envisagés en cas de douleurs abdominales aiguës.
- Former les médecins aux pathologies rares : certaines maladies, bien que peu fréquentes, doivent être mieux connues des professionnels de santé pour éviter des erreurs de diagnostic aux conséquences dramatiques.
Ce drame rappelle à quel point un simple diagnostic peut avoir des conséquences irréversibles. En tant que parents, il est essentiel de rester vigilants et de ne pas hésiter à demander des examens plus approfondis en cas de doute.








